Sonko et la critique de la démocratie libérale : vers un modèle alternatif ?

Ousmane Sonko s’inscrit dans un paysage politique où la démocratie libérale est, en apparence, le régime de référence. Multipartisme, élections périodiques, séparation des pouvoirs, liberté d’expression : autant de principes formellement admis au Sénégal comme dans la majorité des pays africains postcoloniaux. Mais Sonko, dès ses premières prises de position publiques, adopte une posture critique vis-à-vis de cette architecture politique, qu’il juge à la fois incomplète, dévoyée et historiquement inadéquate.
Sa critique ne vise pas la démocratie en tant qu’idéal, mais le modèle libéral importé tel qu’il a été appliqué dans les contextes africains, avec ses instruments formels mais ses résultats inégaux. Ce qu’il remet en question, c’est la promesse non tenue : celle d’un État juste, responsable et souverain fondé sur le consentement populaire. À ses yeux, la démocratie libérale actuelle camoufle une oligarchie élective, organisée autour d’un système de capture des ressources, de contrôle des institutions et d’inféodation aux puissances extérieures.
La posture de Sonko n’est donc pas un rejet de la démocratie, mais une interrogation sur la sincérité du cadre et l’authenticité du fonctionnement.
Le suffrage comme simulacre : une critique de la représentativité
L’un des axes fondamentaux de la critique sonkolienne de la démocratie libérale réside dans la dénonciation du caractère vide du suffrage universel tel qu’il est pratiqué. Pour lui, l’élection, si elle se limite à un acte périodique de vote, ne suffit pas à fonder une légitimité populaire.
Il pointe :
- La manipulation institutionnelle du calendrier électoral,
- La domination de l’argent sur les campagnes,
- L’asymétrie d’accès aux médias,
- La personnalisation du pouvoir au détriment des partis et des idées.
Selon Sonko, le peuple vote souvent sans pouvoir réellement choisir, faute d’offre politique sincère ou de processus électoral transparent. Il évoque un système de façade où le suffrage est préservé dans sa forme, mais vidé de son sens. Le peuple est réduit à un électorat passif, mobilisé à intervalles réguliers puis oublié dans la gestion quotidienne des affaires publiques.
Ce rejet du formalisme électoral sans contenu démocratique le pousse à revendiquer des mécanismes alternatifs de contrôle citoyen, d’implication populaire et de revalorisation des corps intermédiaires.
Une exigence d’éthique publique comme noyau démocratique
Plutôt que d’accepter les cadres importés comme indiscutables, Sonko appelle à refonder l’autorité politique sur une base morale. Pour lui, la démocratie n’a de sens que si elle est portée par une éthique rigoureuse de l’action publique.
Cette exigence se traduit par plusieurs revendications concrètes :
- Obligation de rendre compte de la gestion des deniers publics,
- Publication des patrimoines des responsables,
- Renforcement des mécanismes de contrôle budgétaire,
- Décentralisation effective des compétences et des ressources,
- Responsabilisation des collectivités territoriales.
Dans cette logique, la démocratie n’est pas d’abord un mécanisme procédural, mais une culture de responsabilité. Elle ne se mesure pas à la fréquence des élections, mais à la manière dont l’État sert l’intérêt général, protège les faibles et garantit l’équité.
Sonko propose ainsi une démocratie substantielle, fondée sur des pratiques de justice, et non une démocratie d’apparat.
Vers une démocratie enracinée : représentativité, proximité, souveraineté
Ce que Sonko esquisse, dans ses textes et discours, c’est une démocratie plus enracinée, plus communautaire, plus territoriale, fondée sur des circuits de représentation plus courts et plus réactifs.
Il ne s’agit pas pour lui de récuser les institutions existantes, mais de les articuler à des formes de délibération et de gouvernance locales, où les citoyens ne sont pas de simples destinataires, mais des participants.
Ce modèle suppose :
- Une valorisation des conseils de quartier, des régies locales, des communautés de base,
- Une implication directe des populations dans le suivi des projets publics,
- Une démocratie active, quotidienne, proche.
C’est ici que le discours de Sonko rejoint certaines intuitions du panafricanisme de terrain : redonner une voix réelle à ceux qui, dans le cadre libéral classique, restent invisibles ou inaudibles.
Une critique risquée, mais structurée
Cette remise en question de la démocratie libérale n’est pas sans ambiguïté. Elle peut facilement être caricaturée comme populiste ou démagogique. Certains adversaires l’accusent de mépriser les institutions, de vouloir instrumentaliser le peuple contre l’État, ou de rêver d’une gouvernance autoritaire maquillée en participation populaire.
Mais l’examen attentif de ses textes contredit ces simplifications. Sonko ne propose pas une sortie du cadre démocratique, mais un approfondissement critique. Il veut passer d’une démocratie d’apparence à une démocratie d’adhésion, où les institutions cessent d’être des coquilles formelles pour devenir des outils effectifs de souveraineté populaire.
Cette exigence implique une réforme profonde : celle de la culture politique, de l’éducation civique, de la formation des élites et de la structuration du débat public.
Une ligne de tension permanente : gouverner sans trahir
Depuis son accession à la Primature, Sonko se trouve dans une position délicate : il doit incarner l’État qu’il critiquait, exercer le pouvoir dans un cadre institutionnel qu’il jugeait dévoyé. Ce passage du tribun au responsable implique des arbitrages.
Peut-on remettre en cause une démocratie imparfaite tout en gouvernant avec ses règles ? Peut-on appeler à plus de participation sans sombrer dans la confusion décisionnelle ? Peut-on réconcilier radicalité critique et stabilité institutionnelle ?
Ces tensions, Sonko ne les a jamais niées. Il en fait même le cœur de son projet : tenir ensemble la critique et l’exercice, la parole de rupture et la pratique de l’État. C’est dans cette ligne instable, parfois inconfortable, que se dessine peut-être un modèle alternatif de démocratie : enracinée, éthique, souveraine.





















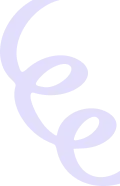

2 Comments
admin
While the law might seem obvious, designers often engage in creative work where they try to reinvent the wheel for the sake of novelty. Of course, we as designers are tasked with providing clients and users with new and inventive solutions, but it is important to understand that there are inherent user expectations and mental models to which we should cater.
admin
Of course, we as designers are tasked with providing clients and users with new and inventive solutions