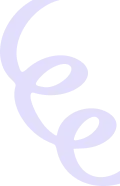Peut-on encore parler d’opposition dans un régime “à deux têtes” ?

Depuis l’installation du tandem Bassirou Diomaye Faye – Ousmane Sonko à la tête de l’État sénégalais, la question de la nature du pouvoir s’est déplacée. On ne parle plus seulement de majorité et d’opposition dans les termes classiques d’un régime présidentiel ou parlementaire. On parle désormais d’une organisation politique à deux visages : un président issu d’une dynamique populaire mais relativement effacé dans la communication publique, et un Premier ministre charismatique, hypermédiatisé, qui fut le véritable centre de gravité du combat politique.
Cette architecture atypique trouble les repères. Elle donne lieu à des lectures diverses, souvent passionnées : certains y voient une répartition stratégique des rôles ; d’autres y perçoivent une source future de tension. Mais au-delà de la mécanique interne du régime, une question centrale demeure : dans un tel système, que devient l’opposition ?
Disparition ou transformation de l’opposition ?
Pendant des années, l’espace public sénégalais a été structuré par une opposition nette et identifiable. Sonko, notamment, en était la figure la plus contestataire et la plus audible. Aujourd’hui, cette opposition s’est institutionnalisée. Elle gouverne. Et ce passage au pouvoir redéfinit radicalement le paysage : ceux qui incarnaient la critique radicale sont devenus comptables de décisions, porteurs de compromis, gestionnaires d’appareil.
Dès lors, l’opposition, si elle existe encore, ne peut plus être pensée seulement comme “ceux qui n’exercent pas le pouvoir”. Elle doit être redéfinie comme ceux qui produisent une critique structurée, indépendante, exigeante du pouvoir en place — quelle que soit leur posture partisane.
Or, aujourd’hui, peu d’acteurs politiques ou intellectuels remplissent cette fonction avec clarté. L’ancien pouvoir est délégitimé, souvent inaudible. Et les nouveaux opposants peinent à trouver un langage crédible face à une équipe qui revendique l’héritage de la résistance.
Un flou stratégique entretenu
L’existence d’un “régime à deux têtes” crée un brouillage. Dans les discours, le président incarne la légalité institutionnelle, la prudence, la continuité républicaine. Le Premier ministre, lui, assume la radicalité, le lien avec les bases, la rupture idéologique. Cette répartition implicite permet de canaliser les attentes tout en dissuadant les critiques frontales : toute attaque contre Sonko est facilement disqualifiée comme déloyale ou injuste, toute interpellation du président est perçue comme prématurée ou déplacée.
Ce flou fonctionne, politiquement. Il neutralise la critique. Il la dissuade par avance. Et il rend difficile pour quiconque de construire une opposition sérieuse, puisque les deux pôles du pouvoir peuvent se renvoyer les responsabilités, jouer de leur complémentarité pour esquiver les contradictions.
Vers une opposition non partisane ?
Dans ce contexte, il est probable que la prochaine opposition sérieuse ne sera pas partisane. Elle ne viendra pas nécessairement des anciens partis battus, ni même des figures connues du champ politique. Elle pourrait émerger de la société civile, des intellectuels, des territoires, des syndicats, des jeunes exclus de la redistribution des espoirs. Elle prendra peut-être la forme d’une critique sur la cohérence, l’efficacité, la fidélité aux promesses.
Mais cette opposition ne pourra émerger qu’à une condition : que le discours du pouvoir n’absorbe pas toutes les formes de langage politique. Que le champ de la parole ne soit pas saturé par les deux figures présidentielles. Que la pluralité ne soit pas seulement tolérée, mais encouragée.
Une démocratie en attente de voix critiques
La démocratie sénégalaise repose historiquement sur une vitalité du débat public. Ce débat ne peut être réduit à un soutien inconditionnel ou à une haine systématique. Il suppose la possibilité d’une parole critique qui ne soit ni traîtrise, ni récupération. Si cette parole est empêchée, par effet de sidération, d’adhésion mystique ou de crainte d’être marginalisé, alors l’opposition ne disparaît pas : elle devient clandestine, souterraine, inaudible.
Dans un régime à deux têtes, l’équilibre ne viendra pas uniquement de la complémentarité des dirigeants. Il viendra de la qualité des interpellations. Et de la capacité du pouvoir à faire face, non à ses ennemis, mais à ses critiques.