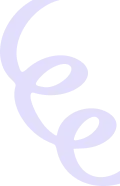Penser l’État avec Sonko : rupture, recentrage ou restauration ?

Depuis ses débuts sur la scène publique, Ousmane Sonko s’est construit dans un rapport frontal à l’État. Non pas à l’idée d’État en soi, mais à la forme qu’il a prise au Sénégal : bureaucratie inefficace, élitisme autoritaire, mainmise néocoloniale, corruption endémique, centralisme paralysant. Cette critique de fond a nourri un imaginaire de rupture, et permis à Sonko d’incarner l’espoir d’un État repensé, remis au service des citoyens. Mais à mesure que son rôle s’institutionnalise, notamment avec son accession à la Primature en 2024, se pose une question fondamentale : le projet de Sonko relève-t-il d’une rupture radicale, d’un recentrage républicain ou d’une restauration morale et institutionnelle de l’État ?
Un État dépossédé : le constat fondateur
La pensée de Sonko repose sur un postulat fort : l’État sénégalais ne répond plus aux besoins fondamentaux du peuple, car il a été vidé de ses fonctions essentielles par un double processus de prédation interne et de dépendance externe. L’administration, loin d’être un instrument d’égalité, serait devenue une machine à reproduire les inégalités, à protéger des privilèges, à déresponsabiliser les élites. L’économie, loin d’être souveraine, serait prise dans des logiques extractives, dominée par des intérêts étrangers. La justice, loin d’être indépendante, serait instrumentalisée au profit du pouvoir politique.
Ce diagnostic sévère est récurrent dans ses discours et ses écrits. Il ne se limite pas à une dénonciation morale, mais se fonde sur une analyse structurelle. L’État est vu comme capturé : par des castes administratives, des clientèles politiques, des partenaires extérieurs, et des mécanismes de dette. Penser l’État, dès lors, ne peut pas se faire dans la continuité. Il faut rompre.
La tentation de la rupture systémique
Le mot rupture est central dans le lexique de Sonko. Il revient sans cesse : rupture avec la France, avec la Françafrique, avec le FMI, avec la gouvernance néolibérale, avec les modes de recrutement clientélistes, avec les lois taillées sur mesure. Cette posture de rupture séduit d’autant plus qu’elle tranche avec la modération tactique des élites classiques.
Mais cette rupture n’est pas anarchique. Elle suppose la construction d’un État fort, réaffirmé dans ses missions régaliennes (justice, éducation, sécurité), recentré sur le service public, décentralisé dans sa mise en œuvre, mais recentré dans sa légitimité. Il ne s’agit donc pas d’un projet libertaire ou d’un affaiblissement de l’État, mais d’un repositionnement fondamental : redonner à l’État ses fonctions protectrices et stratégiques.
Recentrage républicain ou restauration régalienne ?
En accédant au pouvoir, Sonko et ses alliés doivent composer avec les réalités : inertie administrative, poids des partenaires, attentes sociales immédiates. Dans ce contexte, la rupture radicale laisse place à une forme de recentrage. Le discours se stabilise, certaines mesures sont tempérées, la posture se nuance. Cette inflexion n’est pas forcément une trahison. Elle peut être interprétée comme une restauration du sérieux républicain, une volonté de faire fonctionner l’État avec rigueur, méthode, responsabilité. Le mot “refondation” prend alors le pas sur le mot “rupture”.
Il ne s’agit plus seulement de dénoncer, mais de réparer, de réorganiser, de professionnaliser. C’est dans cette logique que s’inscrivent les promesses de recrutement méritocratique, de numérisation des services, de lutte contre la corruption, de relance de la planification nationale, ou encore de révision des contrats extractifs. Ce recentrage vise à rétablir l’autorité publique sans autoritarisme, et à restaurer la confiance entre l’État et les citoyens.
Une tension constitutive : servir l’État ou le subvertir ?
Toute la difficulté réside dans cette tension constitutive : Sonko a bâti sa légitimité en s’opposant à l’État tel qu’il fonctionnait, et il doit maintenant le diriger. Il a mobilisé un imaginaire insurrectionnel, et doit désormais incarner l’ordre. Il a séduit par sa posture d’extériorité, et doit gouverner de l’intérieur. Ce déplacement est périlleux. Car à chaque décision technocratique, à chaque compromis budgétaire, à chaque lenteur administrative, il risque de perdre une part de son capital symbolique.
Mais cette tension n’est pas une impasse. Elle peut devenir une matrice de transformation réelle. Si Sonko parvient à rester fidèle à une certaine éthique du service public, tout en modernisant les instruments de l’action publique, il peut réconcilier rupture et gestion. Il peut faire émerger un modèle sénégalais d’État postcolonial assumé, ni vassalisé, ni populiste, ni technocratique : un État politique, enraciné et stratège.
Une refondation inachevée
À ce stade, penser l’État avec Sonko revient donc à penser une refondation inachevée, pleine de promesses mais aussi d’ambiguïtés. Ni simple prolongement du modèle ancien, ni révolution institutionnelle totale, son approche oscille entre restauration morale, rupture discursive, et recentrage pragmatique.
Ce flou n’est pas nécessairement un défaut. Il reflète les contraintes réelles de la gouvernance, mais aussi l’ambition d’inventer une voie propre, hors des modèles importés. Penser l’État avec Sonko, c’est donc penser une transition politique encore en mouvement, fragile mais décisive, qui engage le Sénégal bien au-delà d’un mandat.