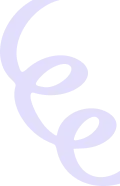Les figures du ‘système’ dans le discours de Sonko : un ennemi pluriel et évolutif

Dans le champ politique sénégalais contemporain, rares sont les termes aussi puissants, aussi mobilisateurs, mais aussi ambigus que celui de « système ». Ousmane Sonko en a fait un mot-clé de sa stratégie discursive, un levier rhétorique capable de condenser des frustrations diffuses et de cristalliser une opposition frontale. Mais ce « système » n’est jamais défini de manière figée. Il évolue, se complexifie, se reconfigure, au gré des moments politiques. Comprendre la manière dont Sonko construit, incarne et combat cette entité multiforme, c’est pénétrer au cœur de sa vision du pouvoir et de sa posture d’opposant devenu acteur.
Une construction du « système » par agrégation critique
Chez Sonko, le système n’est pas une structure technocratique neutre. Il est l’ensemble des forces visibles et invisibles qui verrouillent l’accès au progrès collectif : élites politiques cooptées, réseaux d’affaires opaques, connivences entre justice, administration et sphère économique, relais médiatiques domestiqués. Cette entité est volontairement construite comme une figure globale, qui transcende les partis et les régimes, pour désigner un ordre de domination enraciné.
Mais ce système n’est pas seulement fait de personnes ; il est surtout un dispositif d’inertie, une manière de produire la résignation, de confisquer la souveraineté populaire, de décourager toute tentative d’alternative. Il est l’ordre des habitudes et des intérêts croisés. Cette approche, qui conjugue dénonciation éthique et lecture structurelle, donne à Sonko une posture de rupture qui dépasse la simple alternance.
Les figures emblématiques du système : plus que des ennemis, des archétypes
Le système prend parfois des visages précis. Dans certains discours, Sonko cible directement des figures du régime en place, des magistrats, des chefs religieux alliés au pouvoir, des opérateurs économiques. Mais ces figures ne sont pas désignées uniquement comme des adversaires : elles sont traitées comme les représentations d’un type, comme les visages renouvelés d’un vieux mécanisme. Le ministre n’est pas attaqué parce qu’il est ministre, mais parce qu’il incarne l’allégeance, la compromission, le renoncement.
Cette construction en archétypes permet à Sonko de maintenir une critique globale sans tomber dans l’injure personnalisée. Elle lui donne une latitude discursive importante : même quand les visages changent, le système, lui, persiste. Cela renforce l’idée que le vrai combat n’est pas contre des individus, mais contre une logique.
Un ennemi mouvant, recomposé au fil des épreuves
Ce qui rend le discours de Sonko particulièrement stratégique, c’est la capacité à faire évoluer le profil du système sans trahir son récit central. Dans sa première phase politique, le système était principalement fiscalo-administratif : il dénonçait la fraude, les exonérations injustes, la corruption dans les marchés publics.
Après sa radiation de la fonction publique, le système est devenu judiciaire et répressif : il englobe les magistrats aux ordres, la police utilisée contre les opposants, les lois d’exception. À l’approche des élections, le système est redéfini comme manipulateur de processus démocratique, truqueur de parrainages, faussaire d’élections.
À chaque étape, le système s’adapte — et Sonko adapte sa critique. Il ne s’agit donc pas d’un discours figé, mais d’une construction évolutive, ce qui le rend d’autant plus redoutable pour ses adversaires.
Le « système » comme fonction politique de légitimation
Cette figure ennemie sert aussi une fonction essentielle dans la construction du mythe Sonko. En s’opposant au système, il se place comme le seul porteur de rupture véritable, celui que le système ne peut pas corrompre, récupérer ou neutraliser. Plus le système s’acharne, plus Sonko se légitime. C’est un mécanisme circulaire : l’hostilité du système devient la preuve de son authenticité.
Cela explique la manière dont ses épreuves judiciaires, ses censures médiatiques ou ses assignations à résidence ne l’ont pas affaibli politiquement, mais au contraire renforcé dans son statut de figure d’exception. En cela, le système n’est pas seulement une entité à combattre : c’est un miroir inversé qui permet à Sonko de forger sa légende politique.
Les risques d’un ennemi omniprésent
Mais ce pouvoir du discours n’est pas sans limites. À force de désigner un ennemi tentaculaire, toujours là, toujours coupable, le risque est de produire une lecture trop binaire du réel, où toute opposition devient trahison, toute critique interne devient collusion. Il y a une frontière ténue entre la radicalité éclairante et la paranoïa politique.
Sonko semble parfois conscient de cette tension. Dans certains discours, il appelle à nuancer, à différencier, à ne pas généraliser. Mais l’efficacité politique du mot “système” tient justement à sa plasticité : chacun y projette ce qui l’opprime. C’est cette malléabilité sémantique qui rend la figure du système si puissante — et si problématique.
Dans l’univers discursif de Sonko, le système n’est pas une réalité extérieure figée. C’est un ennemi discursivement construit, dont les contours bougent, mais dont la fonction est constante : justifier l’affrontement, clarifier la ligne de rupture, fédérer les mécontents, et donner à la lutte politique une dimension existentielle. Ce n’est ni une invention, ni une illusion : c’est un outil d’intelligibilité du réel, une figure politique majeure de notre temps.