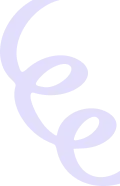La politique de nominations par le gouvernement de Sonko : rupture ou recyclage ?

Le discours de rupture a été l’un des piliers de la montée en puissance d’Ousmane Sonko. Face à un système accusé de cooptation, de clientélisme et de reproduction élitaire, il s’est imposé comme le porteur d’une nouvelle génération politique, promettant compétence, mérite et loyauté envers le peuple plutôt qu’envers des réseaux. Pourtant, à l’épreuve du pouvoir, la politique de nominations du gouvernement Sonko soulève une interrogation fondamentale : assiste-t-on à une réelle refonte des pratiques, ou à une adaptation partielle dans les marges d’un système toujours aussi résilient ?
Des attentes immenses autour des premières nominations
La nomination d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre en avril 2024 s’est accompagnée d’un espoir fort : celui de voir émerger une nouvelle élite administrative et politique, en rupture avec les figures habituelles. Beaucoup espéraient la mise en avant de profils issus de la société civile, d’universitaires, de jeunes technocrates méritants, ou d’acteurs ancrés dans les luttes territoriales et sociales. Il s’agissait pour une partie de l’opinion d’un test symbolique : les visages du changement allaient-ils incarner une transformation réelle de l’État ?
Entre continuités, équilibres politiques et choix assumés
Les premiers mois de gouvernance ont toutefois montré une ligne plus composite. Si plusieurs figures nouvelles ont été propulsées à des postes stratégiques, des acteurs déjà connus de la sphère publique, parfois issus d’anciens régimes ou liés à des dynamiques d’alliance, ont également été promus. Cela a nourri des commentaires contrastés : certains y voient un pragmatisme nécessaire dans une coalition de gouvernement élargie ; d’autres y lisent une forme de recyclage, voire de renoncement partiel à l’idéal méritocratique initial.
Mais il convient de ne pas caricaturer. La rupture n’est pas toujours visible à travers les noms, mais aussi à travers les pratiques internes, les critères de désignation, les cahiers de charges, ou encore les signaux envoyés aux services de l’État. La question n’est pas seulement “qui est nommé”, mais “comment” et “pourquoi”.
Une approche plus stratégique que révolutionnaire
Le gouvernement semble avoir opté pour une stratégie à double étage. D’un côté, il sécurise certaines institutions avec des profils loyaux et compétents issus du vivier patriote, souvent jeunes, et parfois peu connus du grand public. De l’autre, il cherche à maintenir une forme de stabilité institutionnelle et de continuité étatique en conservant certains hauts fonctionnaires ou cadres administratifs jugés indispensables à l’efficacité de l’action publique.
Ce choix peut s’expliquer : une rupture frontale, brutale, aurait pu désorganiser l’appareil d’État, voire déclencher une résistance bureaucratique interne. Mais il pose aussi un problème d’image : la “révolution” promise peut sembler s’émousser lorsqu’elle passe par des arbitrages classiques.
Une gestion de la temporalité politique
Il est possible que Sonko et son équipe aient opté pour une rupture étalée dans le temps. Le changement des visages pourrait venir progressivement, à mesure que des cadres de confiance sont formés, identifiés, ou que des résistances internes sont neutralisées. Mais ce pari sur le temps long comporte un risque : celui de décevoir, voire de démobiliser une partie de la base électorale qui attendait des signaux immédiats, visibles et tranchants.
D’autant plus que la communication officielle sur les critères de nomination reste relativement peu transparente. L’absence de justifications systématiques alimente les soupçons, alors que le régime prétend justement rompre avec l’opacité du passé.
Un enjeu fondamental : reconstruire l’autorité politique autrement
La question des nominations ne concerne pas seulement l’efficacité de l’administration. Elle engage aussi une symbolique puissante : qui incarne l’État ? Quels corps sociaux sont reconnus ? Quel type de leadership s’impose ? Dans un pays où la politique a souvent été perçue comme une fabrique de clientèles, les visages du pouvoir comptent.
C’est pourquoi la question reste posée : la politique de nominations du gouvernement Sonko opère-t-elle une vraie bascule dans les logiques d’accès au pouvoir — ou bien est-elle contrainte de composer avec les vieilles dynamiques pour gouverner sans s’effondrer ?
C’est peut-être là, au cœur de ces choix humains, que se jouera la capacité du nouveau pouvoir à se différencier durablement de ceux qu’il a combattus.