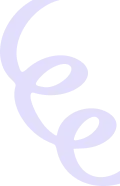Dilemme chez Ousmane Sonko : peut-on incarner l’État et rester radical ?

Il y a, probablement, dans la trajectoire d’Ousmane Sonko une tension fondatrice qui ne cesse de s’amplifier depuis sa nomination comme Premier ministre en avril 2024. D’un côté, Sonko demeure la figure d’une radicalité politique qui a cristallisé des colères sociales, canalisé une volonté de rupture, et redonné une voix à une jeunesse désabusée. De l’autre, il est désormais une institution de l’État, garant du fonctionnement gouvernemental, responsable de décisions, d’arbitrages, de continuité. Cette dualité n’est pas seulement une transition : c’est une contradiction active, parfois productive, parfois risquée. Peut-on incarner l’État sans trahir ce qu’on était en opposition ? Peut-on gouverner sans devenir ce qu’on a combattu ?
Une radicalité fondée sur la dénonciation
Pendant plusieurs années, Sonko s’est défini par le refus. Refus de la dépendance extérieure, refus de l’impunité, refus du néocolonialisme, refus du système. Son langage était celui du dévoilement, de la dénonciation, de la révolte. Il appelait à démasquer les élites, à rompre les compromissions, à assainir les institutions. Cette posture, construite dans le bras de fer avec l’appareil d’État, a forgé son charisme, sa crédibilité et son aura auprès des classes populaires et de larges pans de la jeunesse.
Mais dès lors qu’il devient locuteur d’État, Sonko n’est plus seulement celui qui interpelle : il devient celui qui engage, représente, modère. Il ne peut plus dire sans faire. Il ne peut plus accuser sans réparer. La parole contestataire devient parole performative. Et c’est là que naît le dilemme.
L’État comme machine de compromis
L’appareil d’État, même sous la bannière d’un projet de rupture, fonctionne sur des logiques lentes, juridiques, budgétaires, hiérarchiques. Il impose des arbitrages, des retards, des inerties. Gouverner, c’est négocier avec les faits, avec les chiffres, avec les résistances internes, avec les attentes contradictoires.
Or, une radicalité politique fondée sur des oppositions binaires — peuple contre élite, nation contre impérialisme, éthique contre corruption — résiste mal à l’ambiguïté. Elle se heurte à la complexité du réel. Sonko se retrouve donc dans une position où chaque geste étatique risque de paraître en décalage avec le souffle originel de son combat.
Un contrat signé, une taxe maintenue, un silence diplomatique — et ce sont des partisans eux-mêmes qui interrogent la fidélité à la promesse. D’autant que son pouvoir réel, bien que fort, demeure encadré par la figure présidentielle, le droit positif, et les institutions héritées.
Maintenir la flamme ou assumer l’incandescence
Deux voies s’ouvrent alors.
La première : tenter de maintenir vivante la flamme de la radicalité à travers le discours, les symboles, l’agenda politique, tout en assumant des compromis pragmatiques. Cela implique de transformer la radicalité en réforme cohérente, sans céder sur les principes fondamentaux.
La seconde : rester dans l’incandescence, refuser les logiques étatiques classiques, et imposer une verticalité politique forte, quitte à provoquer des tensions internes au sein même de la coalition au pouvoir et du système institutionnel. Mais cette voie est périlleuse : elle peut mener à l’isolement, à l’immobilisme ou à la rupture.
Dans les deux cas, le danger est le même : perdre la confiance du peuple, soit par excès de normalisation, soit par impuissance à agir dans les limites du réel.
Le dilemme est aussi celui du peuple
La question posée à Sonko est en réalité une question adressée à toute une nation : que voulons-nous vraiment ? Un héros du refus, ou un architecte patient du changement ? Un discours qui secoue, ou une politique qui transforme ? Une épopée, ou une administration efficace ?
Car si le peuple sénégalais attend un miracle, aucun leader ne pourra y répondre. Et si Sonko reste prisonnier de son image de tribun, il pourrait se retrouver incapable de produire les effets réels qu’exige l’exercice du pouvoir.
La radicalité n’est pas une posture éternelle. Elle est un levier, un feu, une alerte. Pour durer, elle doit devenir méthode — ou accepter de disparaître dans sa pureté.