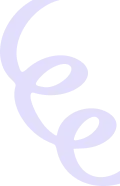De la fiscalité à la justice sociale : la colonne vertébrale du projet Sonko

Dans la pensée politique d’Ousmane Sonko, l’impôt ne relève ni d’un simple outil budgétaire, ni d’un tabou technique réservé aux experts. Il est la clé de voûte du contrat social. Il incarne le lien entre citoyenneté, solidarité nationale et légitimité de l’État.
Issu de l’administration fiscale, Sonko a été confronté, dès l’intérieur, aux déséquilibres du système sénégalais : concentration de l’effort fiscal sur les plus vulnérables, sous-taxation des multinationales, opacité des exonérations, inefficacité chronique du recouvrement, clientélisme fiscal institutionnalisé.
Ce diagnostic n’a pas donné naissance à une simple critique, mais à une pensée structurée : l’impôt doit redevenir un acte civique, égalitaire et transparent. Il ne peut y avoir d’État fort sans fiscalité juste. Et il ne peut y avoir de justice sociale sans État stratège capable de redistribuer.
Contre la prédation fiscale : rupture avec le modèle hérité
L’un des axes majeurs du projet de Sonko est la dénonciation claire d’une fiscalité construite comme instrument de domination, voire de soumission. Dans ses textes et interventions, il déploie une critique frontale du régime fiscal postcolonial, reconduit par les élites locales, qui prélève sans redistribuer, exonère sans justification, et pénalise les secteurs productifs faibles tout en protégeant les rentes.
Le système, selon lui, est doublement pervers :
- Il fragilise les couches moyennes et populaires sous couvert d’élargissement de l’assiette.
- Il offre une sécurité excessive aux groupes économiques privilégiés par des avantages indus.
Ce n’est donc pas seulement une question de niveau de prélèvement, mais de structure de pouvoir dans la fiscalité : qui paie, pourquoi, et pour quoi faire ? Sonko veut inverser les logiques, désactiver les zones d’ombre, et reconstruire une architecture fiscale légitime.
La réforme fiscale comme levier de justice sociale
Ce n’est pas l’impôt en soi qui garantit l’équité, mais ce qu’il permet de financer, d’encadrer, de corriger. Chez Sonko, la fiscalité est directement articulée à une politique sociale ambitieuse.
Trois leviers sont systématiquement mis en avant :
- Élargir l’assiette réelle sans asphyxier l’informel : en ciblant les segments structurés, en adaptant les mécanismes à la réalité des acteurs économiques locaux, et en refusant les logiques brutales d’imposition à l’aveugle.
- Renforcer le contrôle sur les grandes entreprises et les multinationales : en auditant les régimes dérogatoires, en mettant fin aux exonérations prolongées, et en luttant contre les pratiques d’optimisation agressive.
- Garantir la traçabilité de l’impôt dans les politiques publiques : santé, éducation, infrastructures locales, justice territoriale. Ce que le citoyen donne doit pouvoir être vu, compris, et discuté.
La justice sociale, dans cette perspective, n’est ni une abstraction ni une promesse lointaine. Elle est le fruit d’un effort fiscal réorganisé autour de l’équité.
L’impôt comme outil de souveraineté
L’impôt, dans le discours de Sonko, est aussi un marqueur de souveraineté nationale. Il refuse l’idée que l’Afrique doive continuellement financer ses besoins fondamentaux par l’endettement externe, l’aide conditionnée ou les contributions étrangères.
Une fiscalité structurée, suffisante et légitime permet à l’État :
- De réduire sa dépendance aux bailleurs, aux traités asymétriques, aux réformes dictées de l’extérieur,
- De planifier ses investissements selon ses propres priorités,
- D’assumer son autonomie politique, condition préalable à toute souveraineté véritable.
C’est un lien direct que Sonko établit entre fiscalité et indépendance nationale : un État incapable de lever l’impôt de manière juste est un État sous tutelle.
Une pensée mise à l’épreuve de l’action
Depuis avril 2024, Ousmane Sonko occupe la Primature. Ce passage de la dénonciation à la responsabilité implique des arbitrages complexes. Il ne s’agit plus de projeter une réforme, mais de la déployer dans un champ institutionnel contraint.
Les premières annonces ont confirmé certaines orientations de fond :
- Révision des exonérations jugées excessives,
- Encadrement plus strict des marchés publics,
- Préparation d’une loi de finances orientée vers les services de base.
Mais les limites apparaissent également :
- L’inertie administrative freine l’application des décisions.
- Les résistances d’intérêts établis ralentissent les ajustements profonds.
- Les contraintes budgétaires imposées par les engagements extérieurs subsistent.
Il faudra du temps, de la cohérence, et une constance politique rare pour inscrire ces principes dans la pratique institutionnelle. Le défi n’est pas technique : il est politique et moral.
Un test de vérité pour le projet Sonko
Si le cœur du projet est bien celui d’une société plus juste, équitable et souveraine, alors la fiscalité en est la pierre de touche. Ce n’est pas dans les discours, mais dans les budgets, que se lit la fidélité aux engagements initiaux.
Ceux qui ont suivi Sonko pour sa promesse de rupture attendent une refonte visible de l’économie du prélèvement. Ceux qui s’opposent à lui l’observeront précisément sur ce terrain. Et l’histoire, elle, retiendra non pas ce qu’il a dit de l’impôt, mais ce qu’il aura su en faire.