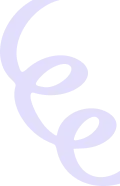Il est frappant de constater que la figure d’Ousmane Sonko, bien qu’elle soit plébiscitée par une partie importante de la jeunesse, suscite un scepticisme, parfois un malaise, chez une frange significative des intellectuels. Pas seulement ceux proches des régimes passés, mais aussi des penseurs indépendants, des universitaires critiques, des artistes engagés, qui ne se reconnaissent ni dans le pouvoir ancien ni dans les structures traditionnelles. D’où vient cette distance ? Est-ce une rivalité symbolique, une réserve éthique ou une divergence de fond ? Entre fascination discrète et inquiétude assumée, la posture des intellectuels critiques vis-à-vis de Sonko mérite d’être explorée avec lucidité.
Le monopole du verbe mis en cause
Sonko n’est pas qu’un homme d’action politique. Il est aussi un homme de discours, un orateur redoutable, un producteur de récits puissants, souvent plus efficaces que bien des essais savants. Dans un pays où la parole publique a longtemps appartenu aux lettrés, la montée en puissance d’un acteur politique qui capte l’attention populaire avec des formules tranchantes, des références maîtrisées, et une capacité à problématiser l’actualité, constitue une sorte de défi.
Il n’est donc pas anodin que certains intellectuels, habitués à interpréter le réel, se sentent dépossédés par un acteur qui fait plus que commenter : il transforme le champ des possibles. Sonko ne se contente pas de diagnostiquer, il mobilise, il affecte, il engage. Cette efficacité discursive peut apparaître, pour certains, comme une forme de court-circuitage du débat intellectuel.
L’inquiétude face à une rhétorique de la rupture
Au-delà des sensibilités personnelles, une partie des critiques exprime une inquiétude réelle : celle d’un discours de rupture qui, à force de vouloir déconstruire, pourrait jeter les bases d’un rapport tendu à la complexité. La critique adressée à Sonko n’est pas toujours de mauvaise foi : elle pointe parfois une radicalité du verbe qui laisse peu de place à la nuance, à la contradiction, à la pluralité.
Certains intellectuels redoutent qu’un tel mode de rapport au réel ne finisse par affaiblir les conditions du débat démocratique, en instituant une ligne morale rigide : le peuple contre les élites, les purs contre les vendus, les patriotes contre les traîtres. Ce schéma binaire, aussi efficace soit-il dans un contexte de lutte, inquiète ceux qui tiennent à la dialectique, à la médiation, à la dissension comme richesse.
Le soupçon d’autoritarisme, réel ou fantasmé ?
Une autre critique, plus souterraine mais récurrente, concerne la manière dont Sonko exerce son autorité sur son camp. Les démissions internes, les prises de distance, les mises à l’écart brutales de certains cadres ont nourri l’idée que le leadership de Sonko ne tolérerait pas la contradiction. Ce soupçon d’autoritarisme — fondé ou non — active chez de nombreux intellectuels une mémoire douloureuse : celle des leaders charismatiques devenus, ailleurs en Afrique, des figures fermées à toute critique, enclines au culte de la personnalité.
Même si Sonko n’a pas encore eu le temps d’exercer pleinement le pouvoir exécutif, l’intensité de l’attente suscitée par sa personne peut faire craindre une fermeture de l’espace critique. Là encore, l’inquiétude ne porte pas toujours sur l’homme, mais sur le mouvement qu’il incarne, ses prolongements, ses dérives potentielles.
Un malaise entre deux élites : politique et intellectuelle
La figure de Sonko semble également mettre à nu un vieux conflit latent : celui entre l’élite politico-militante et l’élite universitaire classique. Le premier groupe revendique l’action, la rue, la transformation concrète. Le second incarne la réflexion, la réserve, la distance critique. Ce clivage n’est pas propre au Sénégal. Il traverse l’histoire des rapports entre révolution et pensée, entre engagement et prudence, entre radicalité et analyse.
Dans ce contexte, la popularité de Sonko peut apparaître comme une remise en cause de la légitimité symbolique des intellectuels, surtout ceux qui ne sont plus perçus comme les voix du peuple. Certains vivent alors ce moment politique comme une relégation de leur rôle historique, d’où une crispation, un repli ou une agressivité mal assumée.
La nécessité d’une critique lucide et constructive
Ce qui est certain, c’est que le projet politique porté par Sonko a besoin d’un écosystème critique pour se consolider, se nuancer, se corriger. Si les intellectuels critiques restent en marge, ou se replient dans le silence ou le mépris, ils perdent toute capacité d’influence sur une dynamique qui, pourtant, façonne le présent du pays.
À l’inverse, si la critique reste enfermée dans le soupçon permanent, elle passe à côté de l’essentiel : les transformations en cours, les ouvertures possibles, les effets sociaux réels de cette expérience politique singulière. Il faut donc appeler à une autre posture : ni adoration, ni dénigrement, mais exigence intellectuelle et politique rigoureuse, au service du peuple et de l’avenir.
L’attitude des intellectuels critiques face à Sonko est révélatrice d’un moment de bascule. Entre défi symbolique, désaccord de fond et peur d’une hégémonie nouvelle, elle reflète la tension entre deux régimes de légitimité : celle du savoir et celle de la représentation populaire. Pour que cette tension soit féconde, elle doit se dire, s’écrire, se penser — et non se réduire à des antagonismes stériles ou à des procès d’intention.