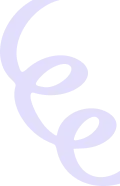Le silence de Sonko est-il encore une stratégie ?

Depuis ses débuts sur la scène politique nationale, Ousmane Sonko a fait du verbe un instrument de rupture. Son discours tranchant, sa capacité à dire l’indicible, son usage décomplexé du wolof et son aisance dans les confrontations médiatiques ont forgé l’image d’un tribun direct, incisif, qui parle quand d’autres calculent. Pourtant, Sonko a aussi pratiqué le silence. Un silence parfois soudain, souvent calculé, et toujours interprété. Il s’est abstenu de commenter certains dossiers brûlants, a évité des plateaux à des moments critiques, ou a laissé planer le doute sur ses intentions. Durant ses assignations, son mutisme était imposé, mais au-delà des contraintes, ce silence était aussi transformé en posture : celle d’un homme que l’on cherche à faire taire, mais dont le silence résonne davantage qu’un discours.
Le silence devient ici stratégie, langage alternatif. Il signifie plus qu’il ne cache. Il laisse la place à la rumeur, au soutien populaire, à la spéculation, tout en renforçant l’aura d’un homme qui ne s’exprime que lorsqu’il l’a décidé.
Le changement de contexte : du silence contestataire au silence gouvernemental
Depuis avril 2024, le contexte a changé. Sonko est Premier ministre. Il ne parle plus depuis les marges, mais depuis le cœur de l’État. Or, ce basculement reconfigure la fonction du silence. Ce qui apparaissait naguère comme une tactique d’évitement légitime ou un acte de défiance devient aujourd’hui un objet d’incompréhension, voire de critique. Lorsqu’il se tait sur des décisions gouvernementales sensibles, sur des débats internationaux importants, ou face à des questions sociales urgentes, ses silences ne sont plus perçus de la même manière.
Ils ne construisent plus un récit de résistance, mais peuvent être interprétés comme un recul de la transparence. Le silence stratégique devient silence institutionnel, avec toutes les attentes de clarté, de pédagogie, et de responsabilité que cela implique.
Silence choisi ou parole empêchée ?
L’une des hypothèses soulevées dans certains cercles est que Sonko, en tant que chef du gouvernement mais non chef de l’État, serait désormais contraint dans sa liberté de parole. La cohabitation politique avec le président Bassirou Diomaye Faye implique nécessairement une coordination, voire une retenue. Dans cette architecture bicéphale inédite, parler trop vite, trop fort, ou trop seul pourrait brouiller le message du pouvoir.
Mais cette hypothèse ne saurait tout expliquer. Car Sonko demeure une figure centrale, influente, écoutée. Son mutisme — même partiel — est un choix. Il ne s’efface pas, mais il réduit la fréquence de ses interventions, leur registre, leur frontalité. Certains y voient une volonté d’incarner un autre rapport au pouvoir : plus sobre, moins conflictuel, plus tactique. D’autres y perçoivent un affaiblissement symbolique, une perte de sa singularité politique.
Une stratégie qui risque l’épuisement
Le silence comme stratégie a toujours besoin d’un horizon. Il fonctionne lorsqu’il s’inscrit dans une dynamique d’attente, de retour, de dévoilement futur. Mais s’il devient habituel, routinier, sans rupture marquante, il s’érode. Le risque est alors double : d’un côté, perdre le lien avec sa base politique historique, friande de prise de parole directe ; de l’autre, alimenter le récit de ceux qui accusent Sonko de fuir les sujets sensibles ou de contourner la conflictualité par prudence.
Un silence trop long, trop flou, finit par ressembler à une absence. Il peut nourrir la défiance, affaiblir l’autorité, désorienter les soutiens. La politique n’est pas seulement affaire de décisions, elle est aussi affaire de récits. Et les silences prolongés laissent d’autres écrire ce récit à votre place.
Le temps de la redéfinition du langage politique
Il est possible que Sonko, en réalité, cherche à redéfinir sa relation à la parole. Moins de mots, mais des mots plus forts. Moins de punchlines, mais plus de fond. Une parole moins polémique, plus institutionnelle, sans renoncer à sa charge symbolique. S’il parvient à transformer ses silences en moments de densité politique — où chaque intervention est attendue, pensée, suivie d’effets — alors le silence restera stratégique.
Mais cela exige de nouveaux outils : une meilleure lisibilité de son action, un relais institutionnel clair, un effort d’explication collectif. Sans quoi, le silence risque de ne plus être un langage, mais une césure.
Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si Sonko se tait pour résister, mais s’il peut encore se taire pour rassembler. Le silence n’est plus une force dès lors qu’il cesse d’être lisible. Pour qu’il reste politique, il doit être ponctué, tendu, signifiant. Dans un pouvoir démocratique, le silence ne protège plus : il oblige.