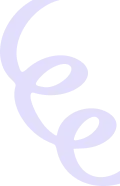La communication gouvernementale à l’heure Sonko

Depuis son entrée en fonction comme Premier ministre, Ousmane Sonko donne un visage singulier à la communication gouvernementale. Là où la tradition sénégalaise avait habitué à une parole officielle balisée, souvent prudente et descendante, Sonko bouscule les formes, les rythmes, et les codes. Cette mutation n’est pas simplement stylistique : elle traduit une certaine conception du pouvoir, de la relation au peuple, et de la bataille pour l’hégémonie symbolique. Reste à savoir si cette communication produit un effet de clarification ou de brouillage.
Une parole directe, personnelle et frontale
Dès les premiers jours de sa nomination, Sonko a opté pour un mode de communication ultra-direct : conférences sans filtre, longues vidéos explicatives, interpellations en wolof, critiques ouvertes envers certaines pratiques du passé. Il s’adresse sans intermédiaires, souvent dans un registre de proximité avec “le peuple”, réactivant les ressorts qui ont forgé son capital politique hors des canaux institutionnels.
Cette parole frontale se veut pédagogique, mobilisatrice, mais aussi offensive. Elle vise à maintenir le lien direct tissé dans l’opposition, tout en affirmant une posture d’homme d’État resté fidèle à sa ligne. Ce choix, s’il rompt avec la communication lisse des gouvernements précédents, entraîne une confusion des rôles : parle-t-il en tant que Premier ministre ou en tant que leader d’un camp ? S’exprime-t-il au nom du gouvernement ou du projet Sonko ?
Une stratégie d’encadrement narratif du pouvoir
La communication à l’ère Sonko n’est pas improvisée. Elle obéit à une stratégie : créer un récit alternatif du pouvoir en cours. Le gouvernement ne se présente pas comme un simple successeur, mais comme une correction historique, un réajustement du rapport entre gouvernants et gouvernés. Cette mise en récit passe par des choix lexicaux forts (rupture, assainissement, souveraineté), des symboles (rupture protocolaire, proximité avec la base, mise en scène du “terrain”), et une volonté de s’opposer aux “éléments de langage” classiques.
On assiste à une forme d’horizontalisation de la parole publique, qui veut court-circuiter les filtres médiatiques, rendre compte de l’action de manière brute, sans “habillage”. Mais cette horizontalité peut aussi devenir source d’ambiguïtés : à trop vouloir parler sans intermédiaires, on affaiblit parfois la parole collective, on désinstitutionnalise la voix de l’État.
Le poids de l’héritage militant
La communication de Sonko garde les traces de son passé militant et contestataire. Elle repose sur la conflictualité, la dénonciation, le dévoilement des “mensonges d’État”. Cette rhétorique a été d’une efficacité redoutable dans l’opposition. Mais appliquée à la gestion gouvernementale, elle pose un défi : comment continuer à mobiliser contre le système quand on est désormais en charge de le faire fonctionner ?
Cette tension est visible dans la dualité du ton : pédagogique et solennel d’un côté, vindicatif et ironique de l’autre. Ce double registre peut galvaniser la base, mais aussi déstabiliser les institutions. L’enjeu est donc de réinventer une parole politique qui assume le pouvoir sans renier la promesse de refondation.
L’absence d’une communication gouvernementale institutionnalisée
Pour l’instant, la communication gouvernementale semble très concentrée sur la figure de Sonko lui-même. Les ministres communiquent peu, et le dispositif institutionnel (porte-parole, conférences régulières, rapports synthétiques) reste encore à consolider. Ce déséquilibre peut poser problème à moyen terme : il fait reposer l’essentiel de la dynamique médiatique sur une figure unique, exposée, clivante, et sujette à surinterprétation.
La verticalité charismatique peut difficilement remplacer une architecture professionnelle de communication publique. Une administration moderne ne peut se contenter d’un discours incarné ; elle a besoin de visibilité, de lisibilité et de cohérence dans tous ses segments.
Vers quelle maturité médiatique ?
La communication à l’heure Sonko est encore en phase de transition. Elle cherche à conjuguer rupture politique et exercice de l’État, mobilisation populaire et langage institutionnel, singularité du leader et expression collective. C’est un chantier ouvert, qui devra affronter les contradictions entre le verbe radical et la prudence de gestion, entre la scène militante et les exigences de la gouvernance.
À terme, l’efficacité de cette communication ne sera pas jugée seulement à sa capacité à captiver ou à déranger, mais à sa faculté à construire une intelligibilité partagée de l’action publique, à faire du discours un outil de transformation — et non de crispation. C’est sur ce fil ténu que se jouera l’avenir du style Sonko dans l’État.