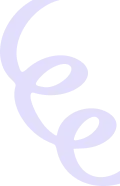Ce que dit vraiment Sonko sur la souveraineté économique

Depuis une dizaine d’années, le mot « souveraineté » est revenu au centre des discours politiques au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains. On le répète, on l’applaudit, parfois on le caricature. Mais dans cette profusion oratoire, peu de voix l’ont articulé avec autant d’insistance, de cohérence et de radicalité qu’Ousmane Sonko.
Dans sa bouche, la souveraineté n’est pas un slogan. C’est une colonne vertébrale idéologique. Un projet structurant. Un concept mobilisateur. Un instrument de rupture. Pour comprendre ce que Sonko propose réellement, il ne suffit pas de le citer. Il faut l’entendre dans la durée, dans l’évolution de son discours, et surtout dans le lien profond qu’il établit entre souveraineté économique et dignité nationale.
Une souveraineté pensée comme préalable à toute transformation
Chez Ousmane Sonko, la souveraineté économique n’est pas un pilier parmi d’autres. Elle est la condition de possibilité de tout changement. Elle précède l’éducation, la santé, l’emploi, la culture. Car, dit-il, un pays qui ne contrôle ni ses ressources, ni sa monnaie, ni sa politique fiscale, ni ses choix d’investissement ne peut prétendre gouverner durablement.
Dans Solutions, son ouvrage de référence publié en 2018, il écrit :
« Il ne s’agit pas de réinventer la roue, mais de sortir du cercle. Le cercle vicieux de la dépendance, du mimétisme économique, du pilotage budgétaire téléguidé de l’extérieur. »
Cette phrase, en apparence simple, contient toute l’ossature de sa pensée : la souveraineté n’est pas un caprice nationaliste, mais un impératif structurel.
Ressources naturelles : l’appropriation comme socle
L’un des terrains d’expression les plus précoces et les plus virulents de Sonko est celui des ressources naturelles. Dès 2016, dans Pétrole et gaz au Sénégal : chronique d’une spoliation, il dénonce les conditions opaques des contrats pétroliers et gaziers signés par l’État sénégalais.
Il y accuse nommément les autorités d’avoir cédé des pans entiers de la souveraineté énergétique à des multinationales, souvent dans des conditions contractuelles iniques. Il fustige les clauses de stabilité fiscale, les exonérations prolongées, le flou des mécanismes de partage de production.
Mais surtout, Sonko y défend un principe fondamental : les ressources naturelles doivent appartenir au peuple — non pas en droit symbolique, mais dans les faits, dans la gestion, dans la redistribution, dans les priorités d’investissement.
Fiscalité : la souveraineté dans la justice
Pour Sonko, la souveraineté économique est inséparable de la souveraineté fiscale. Il ne suffit pas de produire pour soi, il faut prélever justement pour soi. L’architecture fiscale du Sénégal, héritée de l’époque coloniale et perpétuée par les gouvernements successifs, est pour lui un dispositif de prédation à peine déguisé.
Il dénonce :
- La surimposition des petites entreprises et des ménages,
- La tolérance à l’évasion fiscale des grandes firmes,
- Le poids écrasant de la dette fiscale intérieure,
- La passivité des autorités face aux abus d’exonération.
Son projet fiscal est clair : refonder l’impôt pour en faire un instrument de souveraineté populaire, à la fois redistributif, transparent et rationnel.
L’État face au marché : une rupture assumée
L’un des points les plus marquants du discours économique de Sonko est son refus du fétichisme du marché. Contrairement à d’autres dirigeants africains, qui parlent de souveraineté tout en se pliant à la logique néolibérale, il assume une position frontalement critique vis-à-vis des dogmes imposés par les institutions financières internationales.
Il ne s’agit pas pour lui de rejeter l’investissement privé, mais de recentraliser l’État comme acteur économique stratégique, capable :
- D’orienter les priorités productives,
- De réguler les flux,
- D’impulser une industrialisation ciblée,
- Et de planifier sur le long terme.
C’est là un héritage postcolonial inversé : là où l’État était un instrument de domination économique, il doit devenir un levier de libération économique.
Une souveraineté enracinée dans l’imaginaire populaire
Ce qui frappe chez Sonko, c’est sa capacité à traduire un concept complexe dans le langage du peuple, sans le vider de sa substance.
Quand il parle en wolof de ndep luñu kooy jox, (le pouvoir de décider pour nous-mêmes), il ne fait pas que vulgariser. Il crée un pont entre le savoir technique et l’aspiration populaire. Il fait de la souveraineté économique un sentiment collectif, une conscience partagée, pas une abstraction élitiste.
Cette alliance entre savoir et émotion politique est sans doute la clé de son impact. Il ne récite pas des doctrines : il incarne une exigence.
Une idée mise à l’épreuve du pouvoir
Depuis sa nomination comme Premier ministre, la question est désormais simple : que reste-t-il de cette souveraineté économique dans la pratique de gouvernement ?
Certaines orientations ont confirmé sa volonté :
- Priorisation des productions locales dans les marchés publics,
- Révision de certains accords jugés déséquilibrés,
- Limitation de certaines exonérations.
Mais d’autres fronts restent fragiles :
- L’inertie administrative,
- Les contraintes budgétaires et monétaires,
- Les résistances internes à l’appareil d’État,
- Et les pressions extérieures qui, sans être visibles, n’en sont pas moins constantes.
La souveraineté économique, dans le discours de Sonko, est une ligne politique. Dans l’action, elle devient un chemin de crête. Et ce site suivra pas à pas la tension entre ces deux réalités.