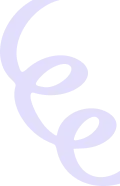Fiscalité, justice, jeunesse : que disent ses premiers actes ?
Les premières décisions d’un gouvernement sont toujours scrutées comme des signaux. Elles indiquent, au-delà des discours de campagne, la manière dont une vision du pouvoir se traduit dans la réalité. Dans le cas de Sonko, les attentes étaient immenses, les promesses fortes, et le contexte inédit : jamais un pouvoir aussi critique du système n’avait eu l’opportunité d’en prendre les rênes. Trois champs méritent une attention particulière pour juger ses débuts : la fiscalité, la justice et la jeunesse. Trois domaines qui cristallisent les fractures sociales autant que les espoirs de transformation.
Fiscalité : une ambition de rupture confrontée aux contraintes
La fiscalité a toujours été au cœur du projet de Sonko. Son expertise de technicien de l’impôt, son passage à la DGID et ses écrits sur la fraude, les exonérations injustifiées et la domination fiscale étrangère ont façonné son image d’homme rigoureux, réformateur et soucieux de justice redistributive. Il ne s’agissait pas seulement de collecter plus, mais de collecter mieux, en ciblant les niches, les abus et les échappatoires.
Les premières orientations prises confirment une volonté de remettre à plat certains régimes d’exonérations, de renforcer le recouvrement, notamment dans le secteur informel supérieur, et d’élargir l’assiette fiscale tout en protégeant les plus vulnérables. Mais les défis sont immenses. Car la réforme fiscale, en Afrique comme ailleurs, se heurte à deux écueils : la résistance des lobbies puissants, et la difficulté à bâtir la confiance dans l’usage des recettes publiques.
Sonko et son gouvernement semblent conscients du besoin de pédagogie, d’équité perçue et de gradualisme. Mais dans ce domaine, l’efficacité se mesurera aux actes concrets, non aux intentions.
Justice : restaurer la confiance sans instrumentaliser
Si la fiscalité était le cœur technique de son projet, la justice en est l’âme symbolique. Les slogans portés par Sonko ont toujours eu une dimension morale : “justice pour tous”, “fin de l’impunité”, “égalité devant la loi”. Il a promis une justice indépendante, débarrassée de son assujettissement au pouvoir exécutif, et plus proche des citoyens.
Les premières mesures, comme l’ouverture de certains dossiers sensibles, la réhabilitation de magistrats radiés ou le discours de fermeté sur les crimes économiques, ont été saluées par une partie de l’opinion. Elles marquent une tentative de reprendre le fil d’une justice perçue comme sélective et inéquitable.
Mais l’équilibre est délicat. La promesse de rupture ne doit pas conduire à une revanche politique. Il faut éviter que les enquêtes apparaissent comme des règlements de comptes. La crédibilité de cette nouvelle phase repose sur la transparence des procédures, le respect du contradictoire, et l’indépendance réelle des juges. Là encore, la réforme institutionnelle devra suivre.
Jeunesse : de la parole mobilisatrice à la réponse concrète
La jeunesse est sans doute la catégorie qui a le plus investi dans le projet Sonko. Elle a marché, crié, résisté, parfois payé le prix fort. Elle attend aujourd’hui des actes à la hauteur de son engagement. La question n’est pas seulement celle de l’emploi — même si elle est centrale — mais aussi de la place donnée aux jeunes dans la décision publique, la formation, l’innovation, la culture.
Plusieurs signaux ont été envoyés : ouverture de nouveaux programmes de formation professionnelle, promesse de refonte de la DER, volonté de soutien aux initiatives locales, lancement de concertations avec des organisations de jeunes. Le ton est volontariste, mais la jeunesse sénégalaise est diverse, exigeante, lucide.
Ce qui est en jeu, c’est moins l’inclusion symbolique que la capacité à construire des réponses durables à une crise générationnelle profonde : désillusion politique, précarité économique, émigration clandestine, déconnexion des systèmes éducatifs.
Une cohérence à construire dans l’action
Pris séparément, les signaux envoyés sur ces trois fronts sont encourageants. Mais ce qui fera la différence à moyen terme, c’est leur cohérence. La réforme fiscale peut-elle financer un nouveau pacte éducatif pour la jeunesse ? La justice peut-elle redevenir un lieu de confiance sociale pour cette même jeunesse ? L’ensemble du projet repose sur cette articulation.
Le gouvernement Sonko est désormais attendu sur sa capacité à convertir l’horizon moral en efficacité politique, à donner chair à ses engagements dans les arènes les plus concrètes du quotidien sénégalais. Car la rupture ne sera réelle que si elle se sent — dans les guichets, dans les tribunaux, dans les quartiers. L’heure est venue de prouver que la parole peut devenir institution.