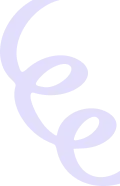Comment Sonko construit son discours panafricaniste

Dans l’espace politique sénégalais, et plus largement africain, le terme “panafricanisme” est souvent convoqué comme une formule d’appartenance morale ou comme une posture rhétorique de défiance à l’égard de l’Occident. Ce mot, lourd de mémoire, de luttes et de déceptions, tend à être galvaudé par ceux qui l’emploient sans réel projet ni cohérence.
Ousmane Sonko ne s’est jamais proclamé théoricien du panafricanisme. Mais son discours, depuis ses débuts, en épouse certaines matrices essentielles. Il ne s’agit pas pour lui de citer les grands noms de la négritude ou de reprendre mécaniquement les thèses des années 1960. Il s’agit de reconstruire une parole politique ancrée dans les urgences contemporaines de l’Afrique, en assumant une filiation de combat, mais sans soumission au folklore idéologique.
Son panafricanisme n’est pas proclamé : il est articulé dans ses prises de position, son lexique politique, son architecture programmatique. C’est un discours de souveraineté, mais aussi de responsabilisation. Un discours de rupture, mais aussi d’unification. Un discours de défiance stratégique, mais pas de fermeture idéologique.
Une souveraineté pensée à l’échelle continentale
Le cœur du discours panafricaniste de Sonko repose sur un principe simple : aucun État africain ne peut véritablement affirmer sa souveraineté dans un isolement politique ou économique. Le Sénégal ne peut recouvrer sa pleine autonomie qu’en l’articulant à une dynamique régionale de libération économique, monétaire, commerciale et géopolitique.
C’est pourquoi Sonko ne se contente pas d’une critique de la dépendance bilatérale ou de la mainmise française. Il inscrit ses propositions dans une logique multilatérale africaine :
- Harmonisation des politiques fiscales au sein de la CEDEAO,
- Renforcement du commerce intra-africain,
- Appui à la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF), mais sous réserve d’un cadre de régulation protecteur,
- Appel à une convergence des politiques minières et énergétiques pour refuser le bradage asymétrique des ressources.
Ce qu’il propose n’est pas un retour à l’autarcie, ni un populisme anti-occidental primaire. C’est un repositionnement stratégique : l’Afrique ne doit plus être une périphérie dispersée, mais une communauté politique capable de peser collectivement dans le monde.
Une parole de combat : le rejet du paternalisme diplomatique
Sonko construit une parole offensive. Dans ses interventions, il n’hésite pas à nommer les puissances tutélaires, à dénoncer les accords léonins, à critiquer les injonctions des institutions financières internationales. Il emploie un langage direct, parfois rugueux, mais toujours appuyé sur une analyse précise des rapports de domination.
Mais il ne s’arrête pas au rejet. Il propose une redéfinition des termes de la coopération, dans laquelle les pays africains prennent eux-mêmes l’initiative de la négociation, au nom de leurs propres intérêts collectifs. Il s’oppose ainsi :
- à la logique de l’aide conditionnée,
- aux accords de défense non transparents,
- aux concessions minières sans contrôle citoyen,
- à la sous-traitance intellectuelle des politiques publiques.
Ce qu’il défend, c’est un rééquilibrage structurel des relations internationales, fondé sur la clarté, la dignité et la mutualisation africaine des rapports de force.
Une construction par le langage : wolof, français, panafricanisme populaire
Un élément rarement analysé, mais essentiel, est la manière dont Sonko fabrique son discours panafricaniste par la langue elle-même. Il navigue entre le français institutionnel et le wolof populaire, et dans ce jeu d’alternance, il opère une traduction politique.
En français, il parle de souveraineté, de recomposition stratégique, de modèles économiques alternatifs. En wolof, il parle d’honneur, de dignité, de “mboolem ak sa bop” — faire avec ses propres forces.
Ce n’est pas de la simple traduction : c’est une territorialisation du panafricanisme, un enracinement. Là où les discours classiques sont souvent déconnectés des réalités quotidiennes, Sonko relocalise le panafricanisme dans l’imaginaire populaire. Il en fait une idée mobilisatrice, incarnée, compréhensible — et donc potentiellement transformative.
Une stratégie de leadership africain assumé
Depuis son accession à la Primature, Sonko ne s’est pas contenté de gérer les affaires internes. Il a multiplié les signaux d’ouverture continentale, renforcé les liens diplomatiques avec certains États critiques du néocolonialisme économique, et proposé des cadres de collaboration plus horizontaux.
Il ne revendique pas un leadership africain en tant que tel. Mais il se positionne, par la force de son discours et de son histoire politique, comme un acteur structurant d’une nouvelle parole africaine, centrée sur la souveraineté, la lucidité économique et la consolidation institutionnelle.
Le discours panafricaniste de Sonko ne repose pas sur des effets d’annonce ou sur une nostalgie post-kémite. Il se construit par la cohérence des positions, la clarté du diagnostic, et la volonté d’action régionale.
Une tension permanente entre ambition panafricaine et réalités étatiques
Ce discours, pour puissant qu’il soit, se heurte à des obstacles majeurs : intérêts géopolitiques divergents entre États africains, blocages internes à l’Union africaine, contraintes économiques multilatérales, faiblesse des mécanismes de convergence juridique ou institutionnelle.
Sonko en a conscience. C’est pourquoi il ne promet pas un panafricanisme immédiat, mais une trajectoire, une série de convergences construites dans le temps, par la diplomatie, la coordination technique, la volonté politique et la pression citoyenne.
Le défi pour lui, désormais Premier ministre, est de transformer ce discours en lignes diplomatiques lisibles, en alliances productives, en coopérations concrètes. Autrement dit : faire du panafricanisme un outil de gouvernement, et non un simple marqueur de positionnement.