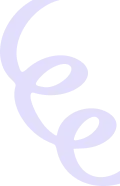Le rôle du peuple dans la pensée politique de Sonko

Chez Ousmane Sonko, le peuple n’est pas un simple décor rhétorique ou un mot creux agité en période électorale. Il est le fondement même de l’action politique, à la fois source de légitimité, moteur de transformation et destinataire ultime du projet étatique. Contrairement à de nombreux responsables qui invoquent “le peuple” de manière abstraite, Sonko tente d’en faire un acteur concret, permanent, organisé, audible.
Cette centralité du peuple traverse tous ses discours : qu’il s’agisse de fiscalité, de souveraineté, de gouvernance ou de justice sociale, Sonko ramène inlassablement la question au point d’origine : qui paie ? qui subit ? qui décide ? qui bénéficie ? En cela, sa pensée politique se distingue par une volonté constante de réarticuler les institutions autour des besoins réels et des aspirations profondes de la majorité sociale.
Une vision populaire, non populiste
La tentation serait grande de ranger Sonko parmi les populistes — cette catégorie floue souvent utilisée pour discréditer ceux qui parlent fort au nom des masses. Pourtant, la relation que Sonko construit avec le peuple n’a rien de simpliste. Il ne flatte pas, il ne promet pas l’impossible, il ne prétend pas incarner à lui seul la totalité du corps social.
Il développe au contraire une vision exigeante du peuple, fondée sur la responsabilisation, la participation et la lucidité politique. Ce peuple qu’il convoque n’est pas une foule à galvaniser, mais une communauté de citoyens à éveiller, à structurer, à faire entrer dans une dynamique de co-construction.
C’est pourquoi son discours met autant l’accent sur l’éducation politique, la décentralisation, la transparence et l’auto-organisation. Il ne s’agit pas d’un peuple tutélaire qu’il faudrait guider aveuglément, mais d’un peuple capable de comprendre, de choisir, d’exiger, de construire.
Le peuple comme contre-pouvoir
Dans la conception sonkolienne, le peuple ne délègue pas une fois pour toutes son pouvoir à une élite. Il doit rester un contre-pouvoir actif, capable de surveiller, de contester, de rappeler à l’ordre ceux qu’il a mandatés. Cela suppose des mécanismes de redevabilité permanents, et pas seulement des scrutins périodiques.
Sonko évoque souvent la nécessité :
- de forums citoyens décentralisés,
- de bilans publics d’action gouvernementale,
- de mécanismes de pétition, de révocation ou de saisine citoyenne,
- d’une presse libre et outillée,
- d’une société civile forte et connectée à la base.
Le rôle du peuple ne se limite donc pas à « participer » : il s’agit de coproduire le pouvoir en imposant une dynamique d’interpellation constante des décideurs. Dans ce schéma, l’État n’est pas un bloc au-dessus, mais une interface vivante entre les aspirations populaires et les dispositifs de transformation.
Une parole de libération politique
Le discours de Sonko s’adresse explicitement à ce que Frantz Fanon appelait “les damnés de la terre” : les laissés-pour-compte, les jeunes sans perspective, les travailleurs précarisés, les agriculteurs délaissés, les diasporas frustrées. Il leur parle non pas comme à des victimes, mais comme à des sujets politiques en puissance.
Il les appelle à refuser la résignation, à reprendre la parole, à organiser la riposte démocratique. C’est une parole de rupture, mais aussi de responsabilisation. Le peuple est invité à ne pas se contenter de se plaindre ou d’attendre un sauveur, mais à devenir stratège de son propre avenir.
Ce message exige du peuple qu’il devienne peuple au sens plein du terme : conscient, organisé, revendicatif, responsable.
Le pouvoir comme mise à l’épreuve du lien populaire
Depuis sa nomination au poste de Premier ministre, la promesse d’un lien politique fort avec le peuple est soumise à l’épreuve de l’exercice. Car dans l’action gouvernementale, les arbitrages s’imposent, les compromis apparaissent, les délais s’allongent. Peut-on gouverner sans rompre le pacte moral qui lie à ceux qui vous ont porté ?
Sonko tente de maintenir cette proximité par une communication directe, des visites de terrain, une explicitation constante des choix opérés. Mais l’exigence reste forte : être fidèle au peuple ne signifie pas tout lui dire, mais ne jamais le trahir. C’est là que réside le cœur de l’équilibre fragile qu’il cherche à tenir : incarner un État qui reste du côté du peuple, tout en assumant la complexité de la gestion.
Une réinvention de la souveraineté populaire
En définitive, la pensée politique de Sonko peut être lue comme un effort de réinvention de la souveraineté populaire dans les conditions contemporaines du Sénégal. Il ne s’agit pas d’un simple retour au peuple comme slogan, mais d’une refondation des institutions autour de lui.
Ce rôle central du peuple implique une autre manière de concevoir :
- l’élaboration des politiques publiques,
- la production du savoir légitime,
- la planification économique,
- la diplomatie même, en lien avec les attentes des communautés.
Le peuple devient le cœur battant de la République. Non plus un mythe qu’on invoque, mais un acteur politique majeur, que Sonko appelle à faire vivre, non par incantation, mais par organisation, vigilance et engagement.