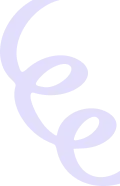Ousmane Sonko a cristallisé une attente politique rare dans l’histoire contemporaine du Sénégal. Pour beaucoup, il a représenté la rupture, la droiture, l’anti-système, le refus du compromis facile. Dans une société traversée par la défiance envers les élites et par le besoin de symboles forts, il est devenu plus qu’un homme politique : une projection collective. Mais une question s’impose aujourd’hui, au moment où il exerce le pouvoir : peut-il rester une idée sans devenir un culte ? Peut-il incarner une orientation politique durable sans être fétichisé comme figure providentielle ?
Dans l’histoire des mobilisations populaires, la ligne est toujours fine entre admiration et absolutisation. Le risque du culte, ce n’est pas seulement l’adoration ; c’est la perte du regard critique, la confusion entre la personne et le projet, entre la voix et le sens.
Le mythe fondateur et ses limites
L’ascension de Sonko s’est faite dans un climat de tension et d’adversité extrême. Radié de la fonction publique, poursuivi par la justice, emprisonné, censuré, diabolisé. Chaque épreuve a renforcé son image d’homme debout, victime d’un système, porteur d’un espoir radical. Ce récit a nourri un véritable mythe politique — celui d’un homme incorruptible, prédestiné, unique.
Mais les mythes politiques, s’ils ne sont pas constamment interrogés, finissent par devenir des prisons symboliques. Le mythe fige. Il empêche la critique interne, il sacralise la parole, il rend inaudibles les voix divergentes. Lorsqu’un homme devient une idée sans nuance, il cesse d’être interpellable. Et tout écart, toute décision imparfaite, toute hésitation devient soit niée, soit justifiée au nom de son intouchabilité.
Une génération sous influence
La jeunesse sénégalaise, en particulier urbaine, a fait de Sonko un repère identitaire. Dans ses discours, elle a entendu une reconnaissance de sa souffrance, une promesse de justice, un langage enfin aligné sur sa colère. Ce lien affectif et politique est une force. Mais il contient aussi un piège : celui de substituer la fidélité à la pensée par la fidélité à la personne.
Les mouvements portés par les figures incarnées risquent de s’éteindre avec elles si l’idée n’est pas nourrie, débattue, complexifiée. Le projet Sonko — s’il existe vraiment comme tel — ne peut tenir que s’il survit à Sonko. Cela suppose une production intellectuelle autour de lui, une pensée politique qui dépasse sa voix, une génération de leaders formés à critiquer et à prolonger plutôt qu’à vénérer.
Une idée ou un refuge émotionnel ?
Il faut aussi interroger ce que représente Sonko pour ses partisans : est-il porteur d’un véritable cadre théorique et programmatique, ou seulement un refuge contre la frustration politique ? Est-il une idée au sens fort — c’est-à-dire un ensemble articulé de principes, de valeurs et de propositions — ou une émotion politique mobilisatrice mais fragile ?
Car une idée se confronte, s’éprouve, se transforme. Une émotion se réplique, se réchauffe, mais ne se structure pas. Si Sonko devient intouchable, alors toute critique sera assimilée à une trahison, toute divergence à une attaque. C’est le terrain fertile des dérives autoritaires, même chez les figures les plus sincères.
Le pouvoir comme épreuve décisive
L’exercice du pouvoir est le moment où la figure politique est le plus exposée à ce risque. Parce que gouverner implique de choisir, de trancher, de décevoir parfois. Ceux qui idéalisent la figure ne supportent pas toujours les décisions qui la contredisent. Et ceux qui l’ont portée comme une idée refusent parfois de la voir devenir un acteur du réel, donc faillible.
Le culte refuse la réalité. Il veut que la figure reste conforme à l’image initiale, pure, résistante, intacte. Mais l’idée politique exige, au contraire, de se confronter au réel, d’en accepter les contradictions, de les penser, de les dépasser. Si Sonko ne parvient pas à désacraliser sa propre figure, à inviter le doute, à intégrer la critique dans sa dynamique, alors il ne pourra plus être une idée active. Il deviendra un monument figé, adoré mais impuissant.
Rester une idée : une exigence, pas une évidence
Rester une idée, c’est accepter de ne pas tout incarner. C’est transmettre, déléguer, inspirer sans absorber. C’est bâtir une école de pensée, pas une chapelle. C’est donner des clés, pas seulement des slogans. Le vrai défi pour Sonko, aujourd’hui, n’est pas de garder la ferveur intacte. C’est de créer les conditions pour que cette ferveur se transforme en culture politique — exigeante, lucide, durable.
Un homme peut éveiller un peuple, mais seul un peuple éduqué politiquement peut faire durer une idée. Le culte est confortable, mais stérile. L’idée, elle, est risquée certes, mais féconde.