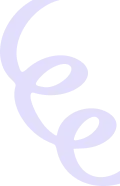Éthique et politique chez Sonko : entre rigueur morale et calcul stratégique

Il est difficile de comprendre la trajectoire d’Ousmane Sonko sans interroger le rapport qu’il entretient avec l’éthique. Car si son ascension fulgurante repose sur une contestation frontale des pratiques politiques dominantes, elle repose aussi sur une mise en récit morale de son engagement. Ce n’est pas seulement ce qu’il dit qui attire : c’est le fait qu’il apparaisse comme celui qui refuse, qui résiste, qui incarne une ligne dans un paysage politique jugé mouvant, opportuniste, complice.
Mais cette rigueur affichée n’est jamais totalement détachée de la stratégie. Elle est construite, maîtrisée, calibrée dans une temporalité politique. Dès lors, il devient pertinent de se demander : la posture morale de Sonko relève-t-elle d’une conviction profonde, ou d’un outil de différenciation ? Est-elle une fidélité personnelle ou une tactique de rupture ?
L’éthique comme identité politique
L’entrée de Sonko dans l’espace public sénégalais s’est accompagnée d’une forte affirmation de probité. Il se présente comme un homme intègre, incorruptible, ayant refusé les compromis internes à l’administration fiscale. Sa radiation en 2016 devient l’acte fondateur d’une figure politique érigée sur le refus — refus du silence, refus de l’alignement, refus de la compromission.
À l’heure où les figures politiques classiques sont perçues comme indifférenciées, Sonko construit sa différence non pas d’abord sur un programme technique, mais sur un profil éthique, une manière d’être et de dire : rigueur, refus des privilèges, simplicité personnelle, absence de scandale privé, transparence sur son patrimoine. Il parle souvent d’exemplarité. Il s’adresse à la jeunesse comme un aîné intègre. Il corrige les journalistes quand les termes prêtent à confusion. Tout concourt à ériger une figure morale du politique, à contre-courant des logiques clientélistes habituelles.
La rigueur morale comme levier de légitimation
Dans un pays marqué par une forte défiance envers les institutions, l’éthique devient un instrument de légitimation autonome. Sonko n’a pas besoin de titre ancien, de famille politique historique, ni de réseau international. Il se forge une légitimité propre, fondée sur la cohérence entre le discours et la posture.
Ce n’est pas un hasard s’il publie lui-même ses ouvrages, refuse certaines alliances, ou s’expose à des risques personnels. Il transforme ses épreuves en preuve : preuve qu’il ne négocie pas avec ses principes. Cette intransigeance devient sa marque. Elle est perçue comme une forme de radicalité par ses opposants, mais comme une consistance morale par ses partisans. En cela, il recompose une nouvelle forme de crédibilité politique au Sénégal, moins fondée sur la longévité ou la position que sur l’alignement entre l’être et le dire.
La stratégie du clivage éthique
Mais cette posture, aussi sincère soit-elle, s’inscrit aussi dans une stratégie. Loin d’être une simple expression de vertu personnelle, l’éthique devient un clivage actif : entre “ceux qui mangent” et “ceux qui servent”, entre les “traîtres” et les “résistants”, entre les “collabos” et les “dignes”. Cette dichotomie morale structure son discours politique. Elle lui permet de polariser, de délimiter un camp, de mobiliser sur une ligne claire : la rupture morale avant même la rupture structurelle.
Cette stratégie est puissante. Elle donne au combat politique une profondeur symbolique. Elle transforme chaque prise de position en test de loyauté, chaque débat en épreuve de vérité. Mais elle comporte aussi un risque : celui de figer la complexité du politique en récit moral binaire. À force de poser l’éthique comme frontière absolue, comment gérer la complexité du pouvoir, le compromis nécessaire, l’imperfection de l’action ?
Gouverner sans trahir : l’épreuve du réel
L’accession d’Ousmane Sonko à la Primature en avril 2024 ouvre une nouvelle phase. Gouverner, c’est désormais affronter les contradictions, les lenteurs de l’administration, les pressions économiques, les logiques d’alliances. C’est négocier sans être corrompu, céder parfois sans renoncer. L’éthique devient alors plus difficile à porter, car elle doit coexister avec la gestion, l’arbitrage, le résultat.
Dès les premières semaines, certaines critiques sont apparues : lenteurs dans les nominations, ambiguïtés sur certaines alliances, prudence calculée dans les réformes. L’homme de principes entre dans l’univers des contraintes. La question se pose avec acuité : comment préserver une ligne éthique dans un champ politique dominé par la tactique, les urgences, et les rapports de force ?
Une morale d’action ou un discours de légitimation ?
On peut enfin interroger le statut même de l’éthique chez Sonko. Est-elle un guide de conduite au long cours, ou une ressource symbolique mobilisée selon les moments ? La réponse est sans doute double. Sonko croit en l’éthique politique, mais il en maîtrise aussi l’usage politique. Il ne s’agit ni de cynisme pur, ni de candeur absolue, mais d’une hybridation entre conviction et intelligence stratégique.
C’est là que réside une part de sa force : dans cette capacité à mobiliser des registres moraux puissants, tout en restant dans le champ de la conquête du pouvoir. En cela, Sonko ne se contente pas de critiquer la politique sénégalaise : il tente d’en redéfinir les codes. Reste à voir si cette refondation sera tenable dans la durée — ou si elle se heurtera, comme tant d’autres, à la dure loi du réel.