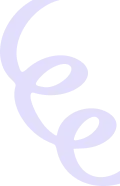Du tribunal à la rue : l’ascension d’un mythe politique

Il est rare, dans une démocratie contemporaine, qu’un homme construise sa stature politique non pas malgré la justice, mais à travers elle. Ousmane Sonko n’a pas seulement affronté les tribunaux ; il en a fait l’un des lieux de sa légitimation publique. Ce déplacement du centre de gravité politique, du Parlement au prétoire, puis du prétoire à la rue, est au cœur d’une trajectoire singulière, où l’intime, le judiciaire, le symbolique et le politique s’entrelacent pour produire un effet rare : la mythification d’un opposant en figure populaire nationale.
Ce parcours, loin d’être linéaire, est fait de confrontations, de fractures, de violences, mais aussi de résistances, de narrations et de mobilisations collectives. C’est cette trajectoire – du tribunal à la rue – qui a hissé Sonko au rang d’icône politique. Une icône clivante, certes, mais désormais indissociable de l’imaginaire politique sénégalais contemporain.
L’arène judiciaire comme lieu de politisation
Tout commence avec un procès, ou plutôt plusieurs. En 2016, sa radiation de la fonction publique pour avoir dénoncé des pratiques fiscales opaques dans l’administration ouvre un premier front : celui de l’affrontement avec l’institution. Cette rupture produit une bascule. Sonko ne sera plus fonctionnaire ; il sera politique. Et ce passage ne se fait pas par une campagne électorale traditionnelle, mais par une prise de parole en forme d’accusation publique. Dès lors, chaque convocation, chaque dossier judiciaire, chaque audience devient un moment d’exposition, un espace de récit.
Le procès Adji Sarr, en 2021, constitue un tournant. Au-delà des faits – que la justice a traité sous l’angle pénal –, c’est l’arène médiatico-politique qui s’enflamme. Ce procès devient le lieu d’un double récit : pour les uns, celui d’un homme à juger ; pour d’autres, celui d’un homme à abattre. Dans cette polarisation, Sonko active un registre qui le propulse : celui de la victime résistante, du leader persécuté, du tribun empêché. Et ce récit trouve un écho massif dans une jeunesse déjà acquise à sa cause.
La rue comme légitimation parallèle
Mais c’est surtout dans la rue que se construit le mythe. La rue n’est pas ici simple théâtre de contestation. Elle devient un espace de reconnaissance politique. À chaque arrestation, assignation ou blocage, des milliers de jeunes descendent dans les rues, dans les quartiers, parfois dans les zones rurales. On scande son nom, on peint son visage, on cite ses phrases. Ousmane Sonko ne parle plus seulement dans les meetings ; il est devenu une silhouette projetée sur les murs, une référence dans les discussions, un drapeau pour ceux qui n’en ont plus.
Cette résonance populaire n’est pas spontanée. Elle s’inscrit dans une construction méthodique, où Sonko alterne silence et parole, appel au droit et dénonciation de l’arbitraire, posture pacifique et défiance assumée. Il orchestre sa propre visibilité à travers l’absence, transforme les restrictions en leviers, les accusations en démonstration de force morale. Il maîtrise le temps politique comme une dramaturgie.
Une figure construite par l’adversité
À la différence de nombreux leaders qui construisent leur légitimité dans l’exercice d’un mandat ou d’une fonction, Sonko s’est forgé dans l’adversité. Et pas une adversité symbolique : menaces, blessures, condamnations, isolement. Mais aussi une adversité partagée. Car son histoire personnelle devient vite un récit collectif. Il est celui qu’“ils” veulent faire taire. Et dans ce “ils”, chacun projette le pouvoir, le système, les forces hostiles à la jeunesse ou aux classes populaires. Cette projection transforme une trajectoire individuelle en mythe politique.
Ce processus s’accompagne d’une forme d’élévation morale : plus il est visé, plus il semble pur. Ce phénomène – risqué, car propice au culte – s’explique aussi par l’absence d’alternatives crédibles perçues comme capables de résister au système. Sonko devient un miroir, parfois idéalisé, des frustrations sociales.
Une ascension au prix d’une tension permanente
Mais cette ascension n’est pas sans coût. Elle repose sur une tension permanente entre confrontation et institutionnalisation, entre incarnation du refus et exercice de la responsabilité. Devenu Premier ministre en avril 2024, Sonko entre dans une phase nouvelle où la rue ne suffit plus, et où les tribunaux ne peuvent plus être son principal espace de légitimation. Il lui faut gouverner, convaincre, réformer – sans perdre ce qui a fait de lui un mythe.
Cette tension est centrale : peut-on rester un symbole radical tout en étant chef du gouvernement ? Peut-on continuer à dénoncer le système tout en ayant la charge de le faire fonctionner ? Ces questions ne sont pas rhétoriques ; elles dessinent l’horizon incertain de la figure Sonko dans les mois à venir.
Un mythe actif, mais fragile
Le mythe politique de Sonko n’est pas un produit de communication. Il est le résultat d’une lutte réelle, d’un parcours heurté, d’un engagement personnel risqué. Mais comme tout mythe, il est aussi fragile. S’il ne se renouvelle pas, s’il ne se transforme pas en projet collectif opérant, s’il devient culte ou se dissout dans la gestion quotidienne, il peut se fissurer.
Pour l’heure, il demeure un cas rare dans l’histoire sénégalaise : celui d’un homme qui, sans avoir été élu président, a occupé les esprits comme peu de chefs d’État. Un homme dont le passage par les tribunaux a ouvert une voie inattendue vers le cœur du peuple. Un homme qui, en descendant dans la rue, y a trouvé son trône symbolique.